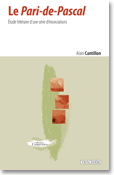Alain Cantillon, Le Pari-de-Pascal. Étude littéraire d’une série d’énonciations, Paris, Vrin, 2014.
Le livre d’Alain Cantillon a le grand mérite de procéder à une déconstruction justifiée d’un des passages les plus célèbres des Pensées de Pascal. La mode de la déconstruction paraît certes datée. La thèse qui donne naissance à l’ouvrage fut entreprise sous la direction de Louis Marin dans les années 1980 et son auteur n’échappe pas aux tics stylistiques et typographiques marquant à la fois l’écriture marinienne et une époque dominée par le soupçon intellectuel vis-à-vis de l’autorité. L’expolition, consistant à répéter la même idée dans des termes équivalents, le zeugme, l’incise, alourdissent et brouillent parfois le propos plutôt qu’ils ne le précisent. Quant au tiret fétiche indiquant que le « Pari-de-Pascal » et les « Pensées-de-Pascal » ne sont que des constructions a posteriori, il peut lasser un lecteur qui croit l’avoir compris sans qu’il soit besoin de le lui rappeler à chaque page. Il reste qu’on ne peut contester la pertinence des questions que pose Alain Cantillon et, entre tous les écrits pascaliens, le soi disant « fragment du pari » commençant par les deux mots « Infini rien ».
Ouvrant n’importe quelle édition de poche moderne (donc composée selon les méthodes Brunschvicg, Lafuma, Sellier ou, dans une moindre mesure, Le Guern), le lecteur néophyte a effectivement l’impression qu’il lit un morceau suivi, comme son auteur l’aurait écrit. Le premier chapitre du Pari-de-Pascal, confirmé par l’appendice donnant en fac-similé les originaux autographes, rappelle qu’il n’en est rien (comme le confirme l’édition électronique en ligne des Pensées, dont on consultera avec intérêt les « transcriptions diplomatiques » reproduisant fidèlement la mise en page chaotique). Pascal a rempli deux feuilles recto verso de paragraphes successifs séparés par des traits ; il ajoute des lignes entre les lignes, complète en marge par de nouveaux paragraphes disposés verticalement, en travers ou à l’envers. L’écriture est, comme toujours, peu lisible, les symboles d’envoi et de renvoi parfois équivoques. L’ordre même des feuilles pose problème ainsi que leur destination dans le projet des Pensées puisqu’elles sont écartées du classement des liasses titrées. Pour rajouter à la difficulté, elles montrent des traces de pliure qu’on ne sait dater. Ces singularités « empêchent quiconque, quelles que puissent être ses qualités de paléographe, de philologue ou d’exégète, quelles que soient les ‘sciences annexes’ utilisées, de donner jamais à lire un texte authentique correspondant aux deux Feuilles ‘Infini rien’ » (p. 92). L’éditeur se trouve devant une mosaïque de trente-quatre « composantes », qu’il doit réordonner selon la succession typographique. C’est passer de deux à une dimension. Chaque « édition » n’est donc, pour Alain Cantillon, qu’une « énonciation », donnant lieu à de nombreuses décisions éditoriales qui restent dissimulées derrière la tranquille apparence linéaire de la chose écrite.
La suite du livre s’applique à étudier dans le plus grand détail la succession de ces réénonciations, en révélant les présupposés éditoriaux, idéologiques, politiques, religieux, de leurs auteurs – rassemblés dans le concept de « lieu d’énonciation » (au sens où l’on dit : « D’où parles-tu ? »). Les copies faites à la mort de Pascal, parce qu’elles ne reproduisent pas la mise en page originelle, représentent la première opération « hétérographique » sur l’autographe, qu’elles transforment en « discours » suivi ‑ à la différence, par exemple, du Mémorial qu’elles ont scrupuleusement refiguré. Elles lèguent ainsi à la postérité la structure que nous connaissons : une ébauche de dialogue, précédée d’un morceau réflexif faisant le parallèle entre connaissance de l’infini et connaissance de Dieu. Elles font de plus des choix paléographiques lourds de sens et de débats futurs : « cela est tout parti » là où le lecteur moderne, à partir de Brunschvicg, lira « cela ôte tout parti » ; « vous êtes embarqués » là où on pouvait aussi déchiffrer « vous êtes au Carquan ».
L’édition princeps de 1670 n’illustre pas véritablement le propos cantillonien puisque son caractère « rhapsodique » est pleinement revendiqué par ses auteurs. Sa longue analyse, soutenue par une synopse permettant de comparer le travail de Port-Royal à celui des deux copistes et à la version Sellier, permet néanmoins de conclure à la fabrication d’une « fiction dramatique », à visée apologétique, dont Pascal serait l’un des protagonistes. Ainsi se trouvait léguée à la postérité une « persona » pascalienne (p. 220) susceptible d’orienter durablement l’interprétation des Pensées comme œuvre apologétique.
Le chapitre suivant élargit doublement le débat par son titre : « La restauration des Pensées-de-Pascal ». Il montre de manière convaincante qu’il s’agissait bien pour Ernest Faugère, premier éditeur opérant le retour aux manuscrits autographes préconisé par Victor Cousin dans son rapport à l’Académie française de 1842, de restaurer un monument du patrimoine national. Le rapprochement avec la politique architecturale du règne de Louis-Philippe fait interroger Alain Cantillon sur la cause profonde de cette volonté de sauvegarde : réaction aux destructions opérées par la Révolution française ? effroi devant les premiers effets de la Révolution industrielle ? La mise en perspective est féconde car elle permet de suivre la destinée des Pensées à la lumière de la définition de Viollet-le-Duc : restaurer un monument, c’est « le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné ». C’est donc suivre un modèle « qui n’est pas nécessairement donné tel quel par l’histoire » mais qu’on élabore « comme une sorte d’idéalité, idéalité singulière, historicisée et pragmatique » (p. 251). Et c’est bien en ces termes que Faugère évoque dans sa préface de 1844 « le monument » qu’il « élève à la mémoire » de Pascal et dont il intitule le second volume : « Fragments d’une apologie du christianisme, ou Pensées sur la religion ».
Alain Cantillon décrit cette énonciation faugérienne comme un « mausolée spirituel », abritant une persona pascalienne qu’il s’agit de « laver » de l’accusation de scepticisme proférée par Victor Cousin – précisément grâce à l’argument du pari, publié en supplément des Pensées sur la religion : « car qu’y a-t-il qui exclue davantage le scepticisme qu’un calcul mathématique ? » fait observer l’éditeur. Une longue analyse des différends opposant ce dernier, qui prétend appliquer les consignes cousiniennes, à Cousin lui-même, qui lui reproche « d’adorer superstitieusement tous les restes d’un grand homme », fait apparaître l’enjeu politique que représente Pascal à la fin d’une Monarchie de Juillet qui se méfie autant des républicains que des catholiques légitimistes. Ce « débat littéraire d’État » illustre, non sans mauvaise foi ni contradictions de part et d’autre, les relations de combat entre philosophie et religion, particulièrement en matière d’enseignement. Au disciple de la raison qu’est Victor Cousin, Pascal sert de cible pour attaquer un christianisme qui n’assujettirait pas ses dogmes à ceux de la raison. Pour le catholique modéré qu’est Faugère, il s’agit de ne pas laisser enfermer Pascal dans un anti-rationalisme qui tournerait au fanatisme. La discussion aurait sans doute gagné à être présentée de manière plus synthétique, mais reste fort intéressante.
L’auteur en appelle en conclusion à un renouveau de la science philologique, taxée de scientisme si elle persiste à prendre pour objet, « en toute chose et sans limite », l’œuvre littéraire seulement – sans donc s’intéresser à la fois aux lieux et aux séries d’énonciations à quoi elle a donné naissance (p. 350). Il importe au contraire de « déployer l’éventail des incertitudes, pour rendre par là aux lectures, et à toutes les énonciations à venir, nous pensons en particulier à tout ce qui touche à ce domaine d’action si précieux que l’on nomme l’enseignement, une plus grande liberté, et un plus grand intérêt ».
À un niveau de recherche, chez des lecteurs professionnels qui travaillent les Pensées depuis des années, nul doute qu’une telle préconisation est salutaire. On sait la difficulté qu’il y a à faire prendre en considération d’autres modèles de lecture que les modèles estampillés ‑ particulièrement celui de l’apologie.
Le risque pédagogique toutefois, si l’on s’intéresse vraiment à transmettre l’intérêt pour Pascal, et parce que ce genre d’exégèse critique demande d’énormes et souvent d’ingrats développements, est à la fois d’ennuyer l’étudiant et de l’égarer dans une accumulation de ce qu’Alain Cantillon appelle lui-même les « zones d’indécision » du texte, jusqu’à perdre tout sentiment que quelque chose comme un écrivain, armé d’une plume et d’intentions, a produit un texte effectif. Comme le dit Pascal lui-même, ou plutôt son double Salomon de Tultie, narrateur des Pensées : « lorsqu’on ne sait pas la vérité d’une chose il est bon qu’il y ait une erreur commune ». Ainsi progresse la pensée scientifique, d’hypothèse en hypothèse et d’erreur en erreur…
Quoique s’en défende Alain Cantillon, le terme même d’énonciation, sa substitution systématique à celui d’édition, contribuent à faire de l’œuvre une entité abstraite, voire inexistante, et à mettre son auteur hors circuit ‑ à le forclore, dirait Lacan, tant ce choix, comme l’incrustation du signifiant Pascal dans les syntagmes « pari-de-Pascal » ou « pensées-de-Pascal » (qui n’est pas sans rappeler l’usage des adresses postales) opèrent la disparition symbolique de l’écrivain en tant qu’auteur.
Car en toute rigueur linguistique, le terme n’est pas approprié. L’énonciation éditoriale n’est pas l’acte de production langagière d’un seul individu. Quelles que soient les manipulations ou ajouts qu’il apporte au texte originel, il y a bien un texte originel que l’éditeur, si l’on veut, cite dans le livre qu’il compose. Le modèle de la parole rapportée semblerait donc plus adéquat pour caractériser cette situation qui est celle, en bonne linguistique, d’une co-énonciation à deux actants, comme la décrit par exemple Alain Rabatet : « une co-construction par les locuteurs d’un point de vue commun qui les engage en tant qu’énonciateurs ». C’est sans doute le nom d’éditeur, dans sa première définition par les académiciens (1762), qui rend compte le plus simplement de ce qui reste un acte de création partagée : « Celui qui prend soin de revoir & de faire imprimer l’ouvrage d’autrui. »